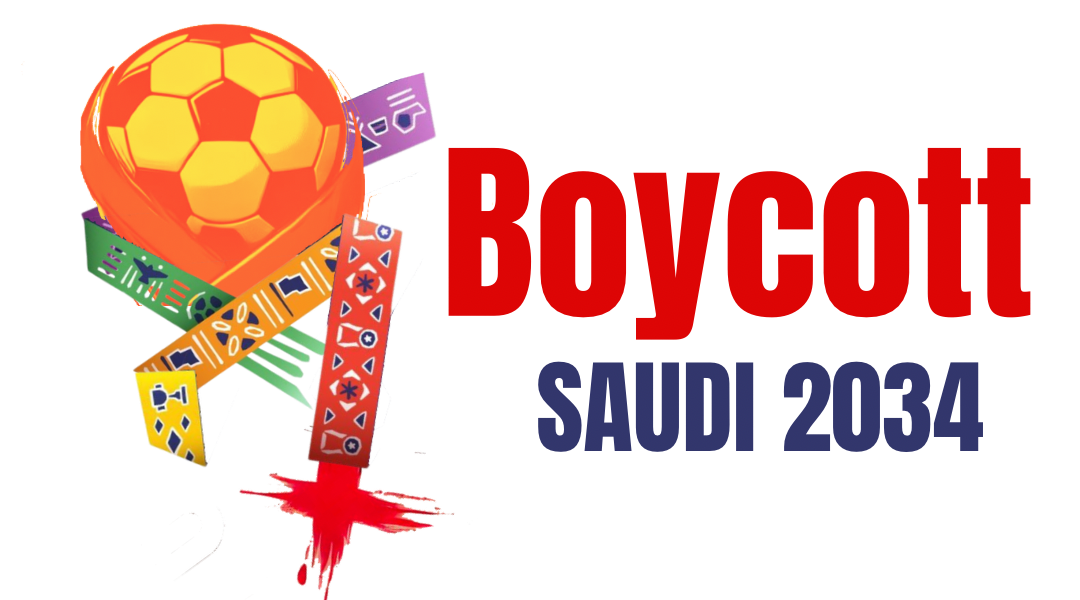Dans un contexte international de plus en plus sensible aux droits humains, à la transparence et à la liberté d’expression, le refus du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS) de participer au Sommet du G7 pour la seconde fois consécutive pose une série de questions inquiétantes. Ce geste ne concerne pas seulement les orientations diplomatiques de l’Arabie saoudite, mais met également en doute sa légitimité à accueillir un événement planétaire comme la Coupe du Monde de la FIFA en 2034.
Pour la troisième fois consécutive, MBS a décliné l’invitation à participer à la plus haute tribune diplomatique mondiale, après avoir déjà brillé par son absence lors des éditions de 2023 en Italie et au Japon. Qu’il s’agisse de raisons de santé ou d’un silence volontaire, cette absence récurrente n’est pas anodine. Elle incarne une stratégie d’évitement délibérée de la part du régime saoudien, qui se détourne systématiquement des plateformes exigeant transparence, redevabilité et engagement envers les normes internationales. Cette incohérence est au cœur de notre appel : la Coupe du Monde 2034 ne doit pas être organisée en Arabie saoudite. La communauté mondiale doit refuser de légitimer ce choix.
Un dirigeant qui fuit les démocraties ne peut incarner l’esprit du football mondial
Le Sommet du G7 n’est pas une formalité diplomatique. Il regroupe les principales démocraties du monde, représentant près de la moitié du PIB mondial, et sert de cadre aux discussions sur le commerce libre, la liberté de la presse, la paix et les droits humains universels. L’absence volontaire de l’Arabie saoudite à cette tribune envoie un message explicite : celui d’un malaise face à ces principes fondamentaux.
Si le prince héritier refuse de dialoguer avec les démocraties les plus influentes du globe, que penser de sa volonté de respecter les normes qui sous-tendent une Coupe du Monde équitable et inclusive ? Comment peut-il garantir la sécurité et la liberté des joueurs, journalistes, supporters et minorités dans un pays dont le bilan en matière de droits humains reste tragiquement bas ? Les questions non résolues autour de l’assassinat de Jamal Khashoggi, les emprisonnements de militantes féministes, et la guerre brutale menée au Yémen ne permettent pas d’envisager sereinement l’accueil d’un tel événement en Arabie saoudite.
L’Arabie saoudite, inapte à accueillir un événement mondial selon les ONG
Des organisations internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International n’ont cessé de dénoncer la situation critique des droits humains dans le royaume. Selon l’Index mondial de la liberté 2024 publié par Freedom House, l’Arabie saoudite obtient un score de 7 sur 100, la classant comme un État « Non libre ». En 2023, plus de cent personnes ont été exécutées dans des conditions dénoncées comme injustes et arbitraires. Les libertés fondamentales, comme celle d’expression ou de réunion, restent lourdement criminalisées. L’homosexualité y est toujours passible de châtiments corporels, de prison, voire de la peine capitale. Quant aux droits des femmes, les réformes récentes ne sauraient masquer des restrictions encore largement contraires aux standards internationaux.
Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les drapeaux arc-en-ciel ont été interdits et les supporters LGBTQ+ ont été mis en garde contre toute démonstration d’affection publique. En Arabie saoudite, ces populations risqueraient des peines bien plus graves. Un tel climat est en contradiction flagrante avec la politique des droits humains de la FIFA adoptée en 2017, qui proclame un engagement à respecter et promouvoir les droits internationalement reconnus. Accorder le Mondial 2034 à l’Arabie saoudite revient à renier cet engagement.
Le sportswashing : maquiller la répression derrière le spectacle sportif
Les investissements massifs du royaume dans le sport mondial — de la création du LIV Golf, à l’achat de Newcastle United, en passant par la Formule 1 — ne répondent pas uniquement à des intérêts économiques ou de divertissement. Ils participent d’une stratégie de « sportswashing », c’est-à-dire une instrumentalisation du sport pour redorer l’image d’un régime autoritaire à l’international.
Depuis l’assassinat de Jamal Khashoggi, attribué à MBS par un rapport de la CIA, l’Arabie saoudite n’a pas corrigé le tir. Elle a au contraire renforcé sa politique de communication par le biais du sport. Ce choix a porté ses fruits : le pays a gagné sept places dans l’Index mondial du soft power en 2022. Mais cette progression en image ne saurait faire oublier la réalité des chiffres : cinq des dix plus grands massacres de la décennie ont eu lieu en Arabie saoudite ; des dizaines de militantes sont encore en prison ou réduites au silence ; et la guerre au Yémen, soutenue militairement par Riyad, a causé plus de 377000 morts selon le PNUD.
Accueillir la Coupe du Monde dans un tel contexte reviendrait à valider cette opération de blanchiment par le sport.
L’absence au G7 révèle une incapacité à faire face à la scène mondiale
Le boycott du G7 par MBS ne doit pas être banalisé. Ce type de sommet prépare les dirigeants à affronter les défis diplomatiques complexes. En refusant d’y participer, le prince héritier démontre une incapacité — ou une peur — à se confronter aux principes démocratiques qui régissent l’espace international.
Cette absence révèle une profonde réticence à toute forme de reddition de comptes. Elle souligne un isolement diplomatique persistant, alimenté par la toxicité politique du dirigeant saoudien depuis l’affaire Khashoggi. Elle montre aussi que le régime préfère agir en marge de la diplomatie ouverte, rendant improbable toute gestion sereine des diversités culturelles, des médias critiques ou des manifestations qui accompagnent immanquablement un événement comme la Coupe du Monde.
Si le prince héritier n’ose pas s’asseoir face à Joe Biden, Justin Trudeau ou Olaf Scholz, comment son régime pourrait-il dialoguer avec des supporters queer, des journalistes indépendants ou des ONG sportives pendant un mois d’exposition planétaire ?
La mobilisation mondiale s’intensifie : rejoignez le mouvement
Depuis 2024, la société civile s’organise. Le hashtag #BoycottSaudi2034 a atteint plus de dix millions de vues sur X (anciennement Twitter), démontrant l’ampleur d’un mouvement naissant. Des figures du monde du football, comme Gary Neville, ont publiquement critiqué la candidature saoudienne, soulignant les dangers que cela représenterait pour les joueurs, journalistes et supporters.
Amnesty International a quant à elle dénoncé une décision « honteuse » de la FIFA, estimant qu’un tel choix « légitime une répression sévère ». Les voix s’élèvent, non seulement contre l’hypocrisie de la FIFA, mais aussi contre l’exploitation cynique du sport pour étouffer les luttes sociales.
Défendre le football, c’est défendre la liberté
Lorsqu’un chef d’État refuse de dialoguer avec les démocraties, lorsqu’il gouverne par la répression, la censure et la peur, son pays ne peut pas devenir l’hôte d’un événement sportif censé incarner l’universalité, l’ouverture et la fraternité. La FIFA doit revenir sur sa décision. Les équipes, sponsors et supporters doivent exiger de la transparence, des garanties claires ou, à défaut, refuser d’y participer.
La Coupe du Monde 2034 en Arabie saoudite n’est pas un tournoi comme un autre. C’est un test moral pour le monde du football. Va-t-il choisir la liberté — ou la répression déguisée derrière des stades flamboyants ?