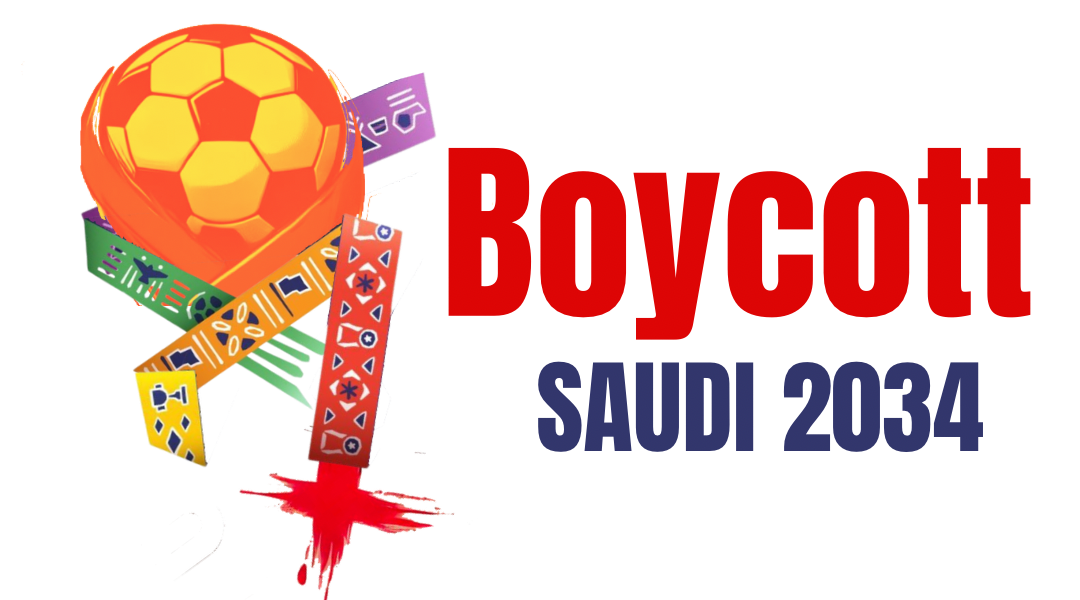L’arrestation de 12 ressortissants étrangers la semaine dernière à Najran, en Arabie saoudite, pour suspicion de proxénétisme, dépasse le cadre du simple fait divers. Elle constitue un nouvel indicateur d’un problème beaucoup plus vaste dans le royaume. En tant que fervent défenseur d’une interdiction faite à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe du Monde 2034, je considère cet événement comme une preuve supplémentaire des dysfonctionnements systémiques en matière de droits humains, de transparence et de justice dans le pays.
Depuis des années, l’Arabie saoudite tente de se présenter comme un État réformateur sur la scène internationale, investissant des milliards dans des campagnes de sportswashing et des relations publiques mondiales. Mais sous le vernis soigné du marketing institutionnel, la réalité est toute autre : l’absence de libertés fondamentales, la violation des droits du travail, et un système juridique autoritaire qui s’abat cruellement sur les plus vulnérables — notamment les travailleurs étrangers.
L’affaire de Najran : le symptôme d’une crise plus profonde
Cinq hommes et sept femmes — soit 12 expatriés au total — ont été arrêtés en juillet 2025 par la Force spéciale des tâches et missions, en coopération avec l’Unité anti-traite et la Direction générale de la sécurité communautaire, pour suspicion de prostitution dans un appartement résidentiel.
Les autorités saoudiennes ont présenté cette opération comme une mesure de lutte contre la traite des êtres humains et la moralité publique. Mais elle soulève de graves questions sur l’abus systématique des travailleurs migrants, le refus d’une justice équitable, et l’incapacité à s’attaquer aux causes profondes de l’exploitation.
Qui sont ces étrangers ? Pourquoi se prostituaient-ils ? Ont-ils été forcés ? Étaient-ils victimes de traite ou poussés par la pauvreté ? Aucune de ces questions fondamentales n’a trouvé réponse. En Arabie saoudite, la transparence n’est pas la norme, et la justice s’applique souvent à huis clos.
Prostitution et traite humaine dans un système répressif
La réaction des autorités saoudiennes face à des problèmes comme la prostitution est profondément inadéquate. Dans la plupart des démocraties, un cas de traite présumée entraînerait en priorité l’identification et l’assistance des victimes. Le système juridique saoudien, fondé sur une stricte application de la charia, criminalise au contraire les victimes, en particulier les femmes et les étrangers.
Cette répression n’est pas motivée par la justice, mais par une volonté de contrôler la moralité publique à travers l’intimidation. Ce climat rend les personnes poussées à se prostituer — par la violence, la coercition ou la pauvreté — doublement victimes : d’abord de l’exploitation, ensuite du système judiciaire.
Ce cas n’est pas isolé. Des dizaines de rapports ont documenté des abus à l’encontre des travailleurs migrants, des réseaux de traite et des violations des droits du travail, notamment parmi les ressortissants d’Asie du Sud et du Sud-Est. Malheureusement, ces affaires font rarement la une internationale, en raison du contrôle sévère de l’information par Riyad et de ses partenariats stratégiques, y compris avec la FIFA.
Sportswashing et Coupe du Monde 2034
La candidature saoudienne à la Coupe du Monde 2034 relève du pur sportswashing. Le royaume tente d’utiliser le football, sport le plus populaire au monde, pour redorer son image, détourner l’attention de ses abus internes, et étendre son influence douce à l’international. Mais permettre à un pays aussi répressif d’accueillir l’événement sportif le plus regardé de la planète envoie un message inquiétant : que les droits humains n’ont pas leur place dans la politique mondiale.
Lorsqu’en 2022 la Coupe du Monde s’est tenue au Qatar, des critiques mondiales ont fusé sur les conditions de travail des migrants et l’absence de droits pour les personnes LGBTQ+. Pourtant, nous n’avons guère tiré de leçon. L’Arabie saoudite pousse encore plus loin ces dynamiques autoritaires.
Un climat de peur pour les étrangers
Les 12 étrangers arrêtés à Najran illustrent la manière dont les migrants sont traités en Arabie saoudite. Beaucoup viennent avec l’espoir d’une vie meilleure, pour se retrouver piégés dans un système sans droits, sans protection, et sans justice.
Et si ces femmes arrêtées étaient des victimes de traite ? Si elles avaient été forcées à se prostituer, manipulées par des réseaux puissants intouchables ? Dans un pays sans médias indépendants ni société civile, ces questions resteront probablement sans réponse.
Les autorités saoudiennes attendent des louanges pour leur « lutte contre le vice », mais ce qu’elles font réellement, c’est détourner l’attention des véritables problèmes structurels : inégalités, absence de protection sociale, et opacité judiciaire.
La FIFA doit agir avec intégrité
La FIFA a le pouvoir de façonner l’opinion mondiale et de fixer des standards moraux. En 1964, elle avait suspendu l’Afrique du Sud en raison de sa politique d’apartheid. Ces dernières années, elle a été de plus en plus appelée à sanctionner les États responsables de graves violations des droits humains.
L’Arabie saoudite n’est pas une exception.
Si la FIFA choisit d’ignorer ces abus et maintient la Coupe du Monde 2034 en Arabie saoudite, elle deviendra complice de la répression. Le rêve des plus grands footballeurs du monde jouant dans des stades potentiellement construits par des travailleurs opprimés, acclamés dans un pays où les femmes ne sont toujours pas pleinement libres, entachera l’histoire du football.
Dites non à l’Arabie saoudite 2034
Je m’associe à ceux qui exigent des comptes, de la transparence et le respect de la dignité humaine. Les arrestations à Najran ne sont pas un incident isolé, mais la preuve d’un système qui punit les faibles et épargne les puissants.
La FIFA doit prendre position. Elle doit rester fidèle à ses valeurs déclarées et refuser à l’Arabie saoudite cette tribune qu’elle cherche à utiliser pour masquer ses crimes.
Si le football est réellement le langage mondial de la paix, de la justice et de l’unité, alors l’Arabie saoudite, telle qu’elle est aujourd’hui, ne mérite pas d’en être la voix.