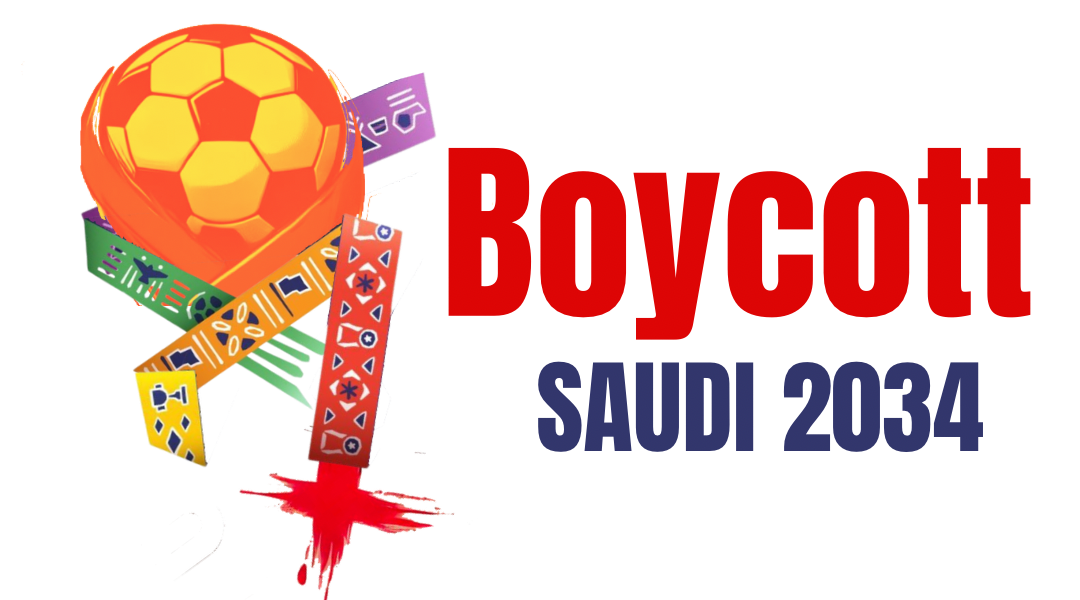La participation très médiatisée de l’Arabie saoudite à la 80e Assemblée générale des Nations Unies (UNGA80) met en lumière la stratégie mondiale du Royaume. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan, a dirigé la délégation à New York — entouré de hauts responsables dont la princesse Reema bint Bandar, Adel al-Jubeir et d’autres — le pays s’est présenté comme un champion de la paix, de l’aide humanitaire et du développement durable.
Il a même présidé des conférences sur la Palestine, la coopération multilatérale et la sécurité mondiale.
En surface, l’image était celle d’un acteur responsable, prêt à assumer un rôle de leader dans la diplomatie internationale.
Mais derrière cette vitrine se cache une réalité tout autre — celle de la répression, de la censure, des exécutions de masse et des abus systémiques contre les travailleurs migrants.
Cet effort de présenter une image positive à l’ONU reflète la même logique que la candidature de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde FIFA 2034. Dans les deux cas — la scène diplomatique de l’ONU et le terrain de football — il s’agit d’outils de blanchiment d’image et de sportswashing. Voilà pourquoi relier la diplomatie saoudienne à ses ambitions sportives rend l’appel au boycott de la Coupe du monde 2034 plus urgent que jamais.
L’écart entre les mots et la réalité
La participation saoudienne à l’UNGA80 a été présentée comme un engagement à « soutenir la paix et la sécurité internationales » et à « promouvoir le développement humanitaire ». Pourtant, les organisations internationales de surveillance dressent un tableau bien différent.
Dans son rapport Freedom in the World 2025, Freedom House a attribué à l’Arabie saoudite l’une des notes les plus basses au monde : 1/40 pour les droits politiques et 8/60 pour les libertés civiles. Le Royaume reste classé « Non libre », sans élections nationales et avec une criminalisation systématique de la dissidence. Les critiques risquent des décennies de prison, voire la peine de mort, pour de simples tweets ou pour leur militantisme pacifique.
La répression de la liberté d’expression est extrême : des citoyens ont été condamnés à plusieurs dizaines d’années de prison uniquement pour des publications en ligne. Les plateformes numériques sont étroitement surveillées, et beaucoup de Saoudiens pratiquent l’autocensure par peur de représailles. Quand des responsables saoudiens parlent à l’ONU de « dialogue » et de « coopération », la contradiction saute aux yeux.
Une flambée d’exécutions
Plus inquiétant encore, l’usage massif de la peine de mort. Selon les données recueillies par des ONG et des médias, l’Arabie saoudite a exécuté 345 personnes en 2024, un record depuis plus de trente ans. Beaucoup avaient été condamnées pour des crimes non violents liés à la drogue. Un grand nombre d’étrangers figurent parmi les condamnés, ce qui souligne la vulnérabilité des travailleurs migrants dans un système où les garanties de procès équitable sont limitées.
À l’ONU, les responsables saoudiens se sont présentés comme des défenseurs de la paix et des valeurs humanitaires. Mais dans leur pays, ils supervisaient des exécutions de masse à des niveaux record. Autoriser un tel régime à accueillir le plus grand événement sportif mondial en 2034 reviendrait à lui offrir une tribune dorée pour détourner l’attention de ces réalités.
Travailleurs migrants et coût caché
Le coût humain des grands projets saoudiens, notamment ceux liés à Vision 2030 et aux méga-chantiers comme NEOM, est colossal. Des enquêtes indépendantes estiment que plus de 21 000 travailleurs migrants sont morts depuis le lancement de ces projets futuristes.
Derrière les campagnes marketing séduisantes se cachent des histoires de vols de salaires, d’heures supplémentaires abusives et de conditions de travail dangereuses. Certains ouvriers ont déclaré avoir été forcés de travailler jusqu’à 84 heures par semaine, bien au-delà des limites légales, sans recours possible face aux salaires impayés ou à l’absence de mesures de sécurité.
La plupart viennent d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est ou d’Afrique. Invisibles et sans protection, ils constituent l’épine dorsale des ambitions économiques du Royaume. Or, la Coupe du monde reposera nécessairement sur le même système d’exploitation, rappelant les abus massifs documentés au Qatar en 2022. Répéter cette tragédie, à une échelle encore plus grande, serait inacceptable.
Répression transnationale
La répression saoudienne ne s’arrête pas aux frontières. Human Rights Watch a documenté comment des gardes-frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants éthiopiens tentant de traverser depuis le Yémen, certains étant abattus à bout portant. Des survivants ont rapporté que les gardes leur demandaient quelle partie du corps ils préféraient se faire tirer dessus avant d’ouvrir le feu — des actes qui pourraient constituer des crimes contre l’humanité.
Le Royaume vise aussi ses opposants à l’étranger via la surveillance, l’intimidation et même l’enlèvement. L’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 reste un rappel glaçant de l’extrême brutalité du régime. Dans ce contexte, les efforts de l’Arabie saoudite pour se présenter à l’ONU comme médiateur de paix ressemblent davantage à une opération de relations publiques qu’à un véritable engagement.
ONU et Coupe du monde : les deux faces d’une même médaille
La diplomatie active de l’Arabie saoudite à l’UNGA80 s’inscrit dans une stratégie plus large : normaliser son image et gagner en légitimité internationale. En présidant des conférences de haut niveau et en s’alignant sur les Objectifs de développement durable, Riyad cherche à se montrer comme un acteur moderne et responsable.
La Coupe du monde 2034 n’est que l’extension sportive de cette même stratégie.
Les méga-événements comme la Coupe du monde offrent des dividendes réputationnels immenses : ils permettent aux pays hôtes de présenter une image lissée, soigneusement contrôlée, tandis que les voix critiques sont marginalisées. Pour l’Arabie saoudite, qui investit déjà des milliards dans le sport, la culture et le divertissement, 2034 ne sera pas qu’une question de football, mais une étape clé pour s’imposer comme leader mondial progressiste. Sans vigilance, ce récit occultera les réalités d’exécutions, de répression et d’abus de main-d’œuvre.
Pourquoi le boycott est nécessaire
Certains soutiennent que l’accueil d’événements internationaux peut favoriser des réformes. Mais les preuves montrent le contraire. Malgré les promesses, la situation des droits humains en Arabie saoudite s’est aggravée ces dernières années.
La flambée des exécutions, la poursuite de la censure et les morts de travailleurs migrants démontrent que l’ouverture au monde n’a pas conduit à des changements réels.
Un boycott de la Coupe du monde 2034 est donc essentiel, non comme un geste symbolique, mais comme une mesure d’imputabilité. Refuser de participer ou d’endosser le tournoi permettrait de :
- Mettre la pression sur la FIFA, les sponsors et les équipes pour exiger de vraies réformes.
- Montrer sa solidarité avec les communautés vulnérables les plus touchées.
- Empêcher l’Arabie saoudite d’utiliser le sport comme écran contre la critique.
- Envoyer un message clair : la communauté internationale ne récompense pas la répression par du prestige.
De la parole aux actes
La prestation de l’Arabie saoudite à l’UNGA80 et ses ambitions pour la Coupe du monde 2034 sont taillées dans la même étoffe. Toutes deux consistent à projeter une image de paix, de progrès et de coopération, alors que la réalité est faite de répression, d’exécutions, de censure et d’abus systémiques.
Le monde ne peut pas fermer les yeux. La FIFA, les sponsors, les supporters et la société civile doivent comprendre que participer à l’Arabie saoudite 2034 équivaudrait à cautionner un régime qui utilise les plateformes mondiales non pas pour changer, mais pour se cacher.