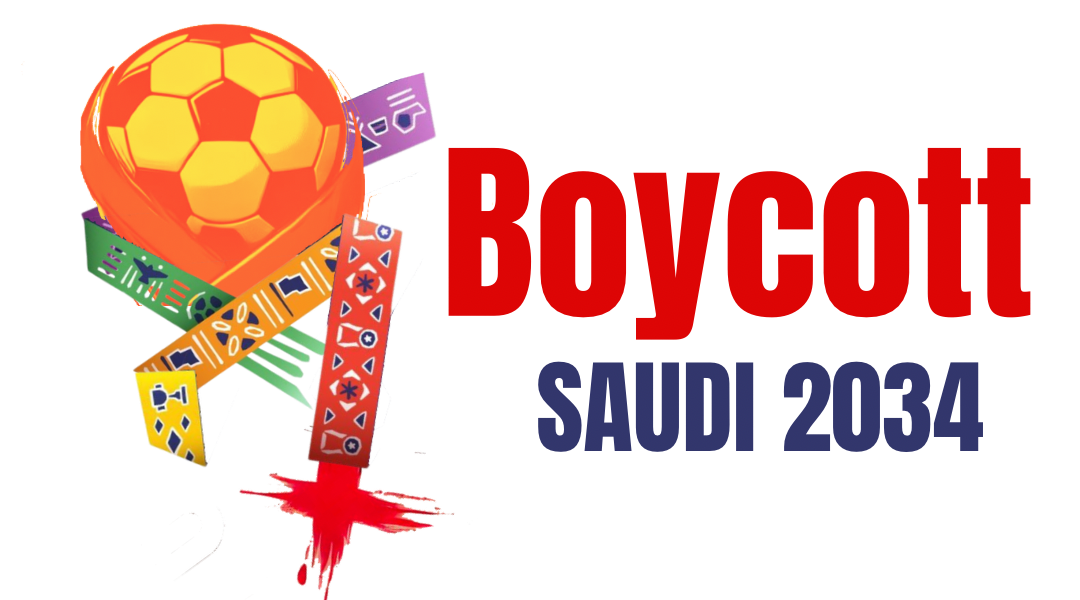Lorsque la FIFA a officiellement annoncé que l’Arabie saoudite accueillerait la Coupe du Monde 2034, ce ne fut pas vraiment une surprise. L’annonce était attendue depuis longtemps — non seulement en raison des ressources financières colossales du royaume ou des liens toujours plus étroits de la FIFA avec des régimes autoritaires, mais aussi parce qu’aucun autre pays n’a présenté sa candidature.
Pourtant, les conséquences sont considérables. Pour la deuxième fois, la plus grande scène du football est confiée à un pays au lourd passif en matière de droits humains. Ce choix en dit long — non seulement sur les ambitions de l’Arabie saoudite, mais aussi sur ce que le sport mondial est devenu : un théâtre où l’on parle de progrès, mais où l’on agit rarement en ce sens.
L’instant de conscience (et de recul rapide) de la Fédération anglaise
Avant la décision finale, la Fédération anglaise de football (FA) aurait discuté d’un éventuel geste de protestation. Des voix s’élevaient pour soutenir les droits fondamentaux : droits des travailleurs, des femmes, des personnes LGBTQ — autant de sujets sensibles en Arabie saoudite.
Certains membres de la FA souhaitaient adopter une position de principe. Un vote symbolique contre l’attribution aurait marqué leur désapprobation face au choix d’un pays à la société ultra-contrôlée et à la répression étouffante pour accueillir l’événement sportif le plus suivi au monde. D’autres allaient plus loin : pourquoi ne pas boycotter tout simplement ?
Mais, comme souvent lorsque l’idéalisme rencontre le pragmatisme, le débat s’est rapidement éteint. Aucun boycott. Aucune protestation. Juste un nouveau cycle de Coupe du Monde enclenché.
L’hypocrisie du sport : principes ou participation ?
Ce cas illustre parfaitement le dilemme dans lequel se trouvent les organisations sportives contemporaines. Des institutions comme la FA ou des médias comme The Guardian évoquent régulièrement les droits humains et le leadership éthique. Mais dans les faits, la passion pour le football l’emporte presque toujours sur les principes.
Lors du Mondial au Qatar en 2022, tout cela était déjà visible. L’Angleterre était arrivée avec de grandes déclarations sur la justice et l’inclusion. Il avait été question que le capitaine Harry Kane porte un brassard arc-en-ciel pour soutenir les droits LGBTQ. Mais dès que la FIFA a mis la pression, le geste a été abandonné.
Le moment de protestation fut aussi bref qu’inefficace. Et l’Angleterre, comme les autres nations gênées, a poursuivi la compétition. Les caméras tournaient, les stades étaient pleins, et les spectateurs du monde entier profitaient d’un mois de drames sportifs intenses.
La réalité, c’est qu’on ne peut pas être indigné moralement par un système tout en en tirant profit. Cette incohérence était flagrante en 2022, et elle l’est déjà de nouveau pour 2034.
Le divertissement avant l’éthique
Ce qui glace le plus, c’est que le public s’en préoccupe… mais modérément. Les récits sur les droits humains dans les pays hôtes de grands événements captent l’attention… quelques instants. La majorité des fans ne veut pas d’un cours de morale pendant un match en direct. Espagne contre Italie, c’est une question de tactique et de buts — pas de géopolitique.
Dans un monde saturé de crises et d’injustices — entre conditions des travailleurs migrants, guerres, catastrophes climatiques et scandales politiques — chacun choisit ses combats. Et rares sont ceux prêts à sacrifier leur plaisir pour une cause morale.
C’est pourquoi ces grands moments de sportwashing, où des régimes autoritaires se servent du sport pour soigner leur image, se répètent. L’indignation est passagère. Le spectacle, lui, perdure.
Le modèle de la Coupe du Monde : démocratie ou dictature ?
Deux modèles s’affrontent. Le premier est démocratique : plusieurs pays co-organisent l’événement. En 2030, par exemple, la Coupe du Monde sera partagée entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec quelques matchs en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. C’est un patchwork probablement conçu pour réduire les coûts et les controverses politiques. Ce modèle se pare d’un vernis vert : « la Coupe du Monde la plus écologique jamais organisée », bien que les supporters devront traverser des continents pour suivre leur équipe.
Le second modèle, c’est celui des dictatures. Une nation, une vision, des fonds illimités. Pas de coalitions politiques compliquées. Pas de référendums publics. Juste une volonté autoritaire de « mettre le paquet ». Voilà ce que promet l’Arabie saoudite — et voilà pourquoi la FIFA n’a même pas organisé de vote cette fois.
Le théâtre du pouvoir signé FIFA
Le 11 décembre 2024, dans un congrès de la FIFA aux allures d’émission de télé, le tampon final a été posé. Sans débat. Sans surprise. Juste une salle pleine de délégués applaudissant à la demande, pendant que le président Gianni Infantino saluait le résultat « par acclamation ». Pas un mot de dissidence. Aucun vote réel requis.
C’était un théâtre politique qui ferait rougir un méchant de James Bond. La déclaration finale d’Infantino — « Le vote du Congrès est clair et net » — relevait plus de la satire que de la gouvernance. Et pourtant, c’est ainsi que fonctionne aujourd’hui l’organisation sportive la plus puissante du monde.
Le vrai rôle du sport : unir, pas moraliser
Certains diront que ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Le but du sport n’est pas de rendre le monde meilleur — mais d’unir les êtres humains. Les Jeux olympiques n’ont pas exclu l’Union soviétique pendant la guerre froide. Pourquoi la FIFA exclurait-elle l’Arabie saoudite aujourd’hui ?
Selon cette logique, la politique s’arrête aux lignes du terrain. L’objectif est simplement de faire jouer les meilleurs joueurs, peu importe leur pays ou leur régime. Exiger davantage — des principes, des protestations, de la moralité absolue — serait irréaliste.
Cet argument a sa part de vérité. Le sport peut être un pont. Il peut ouvrir le dialogue. Mais la perfection ? Ce n’est pas au programme.
Un moment de vérité pour les valeurs occidentales
La Coupe du Monde 2034 va obliger l’Occident — et en particulier les démocraties libérales comme la France, l’Angleterre ou l’Allemagne — à faire face à des questions difficiles. Sont-elles réellement prêtes à se retirer du spectacle ? Ou vont-elles continuer à participer tout en feignant l’indignation ?
Pour l’instant, la réponse est simple. Les mêmes pays qui critiquaient le Qatar soutiennent désormais l’Arabie saoudite. Les contorsions morales pour justifier ce revirement sont ahurissantes — mais tristement familières.
Les nations occidentales aiment proclamer leurs valeurs. Mais quand argent, influence et plaisir entrent en jeu, ces valeurs deviennent étonnamment flexibles.
Arrêtez de faire semblant de protester ce que vous n’abandonnerez pas
Peut-être est-il temps d’un peu d’honnêteté. Si les pays et les organisations ne sont pas prêts à renoncer au confort ou aux revenus au nom de leurs convictions, qu’ils cessent de faire semblant d’être tiraillés. Ne portez pas le brassard. Ne rédigez pas de communiqué. Ne protestez que si vous êtes prêts à faire un vrai sacrifice. Car si vous n’êtes pas disposés à abandonner vos privilèges, alors votre indignation morale n’est qu’un spectacle.