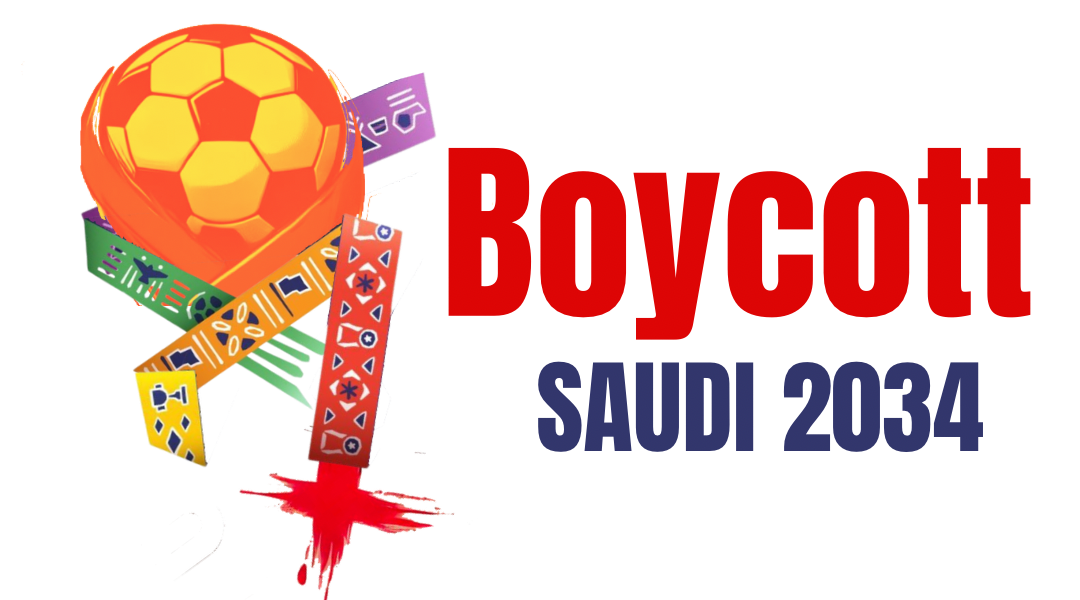La scène mondiale du football n’est pas simplement une célébration de la performance humaine — elle symbolise l’unité, le respect et la dignité. Même si les actualités saluent aujourd’hui l’initiative du Royaume d’Arabie saoudite pour soutenir l’éducation des enfants au Yémen par l’intermédiaire de son agence d’aide KSrelief, il ne faut pas perdre de vue l’essentiel.
Cette nouvelle promesse, aussi belle soit-elle en apparence, risque fort de servir de rideau de fumée à une guerre de dix ans à laquelle l’Arabie saoudite a largement contribué — une guerre qui a ciblé les mêmes communautés qu’elle prétend désormais aider.
Revenons aux faits et voyons pourquoi les actes humanitaires ne peuvent être dissociés du comportement à long terme d’un État, surtout lorsqu’il est question de lui attribuer l’honneur d’accueillir le plus grand événement sportif mondial.
La nouvelle récente : une aide à l’éducation au Yémen
Le 19 juillet 2025, le Centre d’aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief) a signé un accord de coopération pour fournir une éducation aux enfants touchés par le conflit dans le gouvernorat de Lahij, au Yémen. Selon l’Agence de presse saoudienne, le projet bénéficiera directement à 6 833 personnes et indirectement à 16 000 autres. Le protocole d’accord prévoit la distribution de sacs scolaires, de kits d’hygiène, un accompagnement psychologique, une protection de l’enfance et la formation d’enseignants bénévoles.
Bien que ces programmes soient souhaitables et nécessaires — notamment pour la reconstruction post-conflit et l’éducation des filles — une question demeure : qui était partie prenante au conflit au départ ?
L’implication de l’Arabie saoudite au Yémen depuis 2015 est largement considérée comme l’un des principaux moteurs de la tragédie humaine. Les bombardements aériens, les blocus et les guerres par procuration ont entraîné des déplacements massifs, la fermeture d’écoles, des famines et la mort de milliers de civils, dont de nombreux enfants.
Une couverture humanitaire ?
Cette initiative éducative s’inscrit dans une tendance bien connue : des régimes puissants se livrent à une opération de blanchiment de réputation en mettant en avant des actions humanitaires pour dissimuler les dégâts qu’ils ont eux-mêmes provoqués.
La participation de l’Arabie saoudite au conflit yéménite est directement responsable de la destruction d’écoles, d’hôpitaux et de systèmes d’eau. Selon l’UNICEF, au moins deux millions d’enfants yéménites sont actuellement déscolarisés. Les écoles ont été détruites, et l’éducation se résume désormais à un champ de ruines. Peut-on vraiment compenser cela avec des sacs scolaires et des kits d’hygiène ?
C’est une question éthique. Peut-on considérer comme louable qu’un pays ayant financé une guerre ayant détruit le système éducatif d’une génération entière soit aujourd’hui félicité pour quelques initiatives d’aide symboliques ? Et surtout, est-il juste de le récompenser en lui attribuant l’organisation de la Coupe du monde, un tournoi fondé sur les principes de solidarité et d’équité internationales ?
Sportswashing par le football
La candidature de l’Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2034 n’a rien à voir avec le football. C’est une étape stratégique dans une vaste opération de sportswashing — une tentative de redorer son image par le biais du sport international tout en esquivant les comptes à rendre pour ses violations des droits humains.
Acquisition de clubs européens, organisation de compétitions de boxe et de Formule 1, et désormais la conquête du prix ultime — la Coupe du monde — le Royaume utilise le sport pour se réinventer en tant que nation moderne, progressiste et généreuse. Mais c’est une fiction soigneusement orchestrée.
La FIFA doit rester fidèle à ses principes
La FIFA se présente comme une institution attachée au respect des droits humains et à l’inclusion. Ses statuts insistent sur la nécessité de « sauvegarder la dignité et l’intégrité des personnes » et de « promouvoir des relations amicales entre les peuples ».
Accorder la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite, c’est trahir ces principes.
Rappelons le précédent : le Qatar a été vivement critiqué lors de la Coupe du monde 2022 pour sa gestion des droits des travailleurs migrants et des personnes LGBT+. Des réformes ont été engagées sous pression, mais le tournoi a laissé un goût amer, illustrant comment la visibilité internationale peut servir à blanchir l’image de régimes autoritaires.
L’Arabie saoudite va plus loin — tant dans sa répression intérieure que dans son comportement à l’échelle mondiale. L’exemple le plus tragique reste le Yémen. Pour 6 833 enfants, une aide éducative ne compensera jamais des années de bombardements aériens et de sièges ayant affamé des millions d’élèves et détruit leur avenir.
Le coût de l’oubli
Il est facile de saluer les bonnes nouvelles. Un pays qui soutient les enfants. Qui rénove des écoles. Qui éduque des filles. Ces titres embellissent l’image, orientent le récit, et font oublier les responsabilités. Mais pour chaque sac scolaire distribué en 2025, il y a une salle de classe détruite en 2016. Pour chaque kit d’hygiène, une mère privée d’eau potable à cause d’un blocus saoudien. Derrière chaque photo d’un accord signé se cache un cimetière silencieux — et la FIFA risque d’y être complice si elle ne change pas de cap.
Ce à quoi ressemble une véritable justice
Si l’Arabie saoudite souhaite réellement réparer les torts, elle devrait :
- Admettre son rôle dans la guerre au Yémen et financer une reconstruction à long terme.
- Accepter un contrôle international sur les pertes civiles et les crimes de guerre.
- Étendre et protéger les droits humains sur son territoire, notamment pour les femmes, les minorités et les dissidents.
- Mettre fin à la politisation du sport et soumettre son industrie sportive à la transparence.
- Intégrer les voix de la société civile — yéménite, diasporique et internationale — dans ses choix d’aide et de développement.
Voilà ce qu’est la responsabilité. Voilà ce que la FIFA devrait exiger avant d’octroyer une quelconque invitation.
Défendons la justice, pas les apparences
À l’approche de 2034, nous devons nous interroger : Que devenons-nous en tant que communauté internationale à travers le football ?
Favorisons-nous la responsabilité, la transparence et la dignité humaine — ou bien offrons-nous le plus grand tournoi sportif mondial à un gouvernement qui instrumentalise les salles de classe comme monnaies d’échange et l’aide humanitaire comme opération de communication ?
Ne nous laissons pas tromper par la superficialité de la charité.
Souvenons-nous des enfants yéménites toujours privés d’éducation, des défenseurs des droits humains emprisonnés en Arabie saoudite, et de la responsabilité morale que la FIFA a envers ses principes fondateurs.
Signez l’appel pour boycotter la Coupe du monde de la FIFA 2034 en Arabie saoudite. Non pas parce que nous sommes contre le sport, mais parce que nous voulons un sport qui unit sans mensonge, qui émeut sans tromperie, et qui incarne la justice sans frontières.