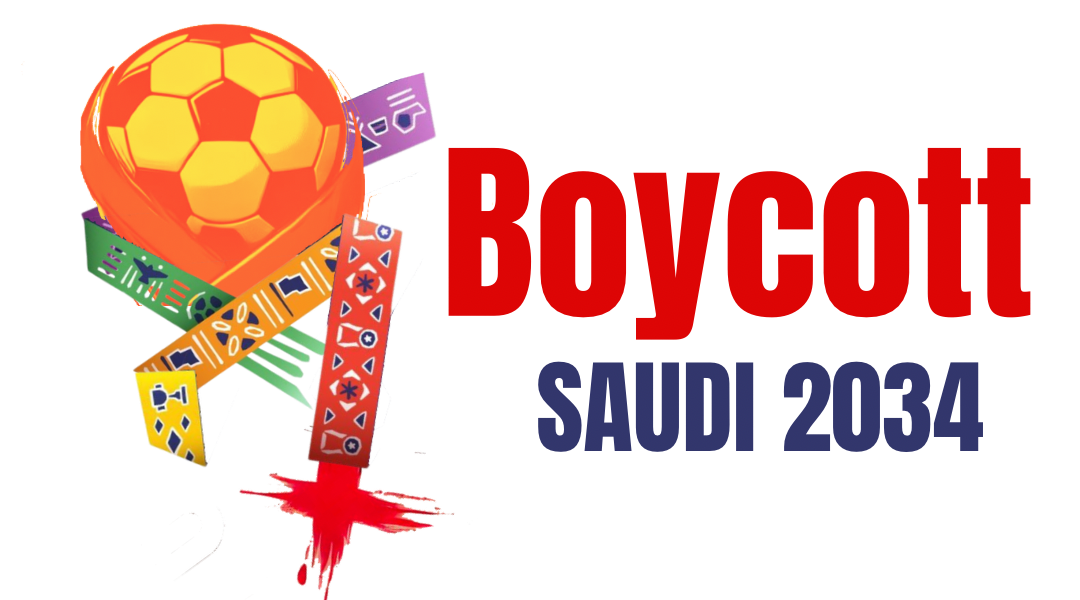La FIFA a officiellement décidé d’attribuer la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite, déclenchant une tempête de débats et de critiques. Certains y voient un potentiel catalyseur de changement, tandis que d’autres dénoncent une contradiction flagrante avec l’engagement proclamé de la FIFA en faveur des droits humains.
L’Arabie saoudite était le seul candidat officiel après que la Confédération asiatique de football (AFC) a rapidement soutenu sa candidature, écartant ainsi une éventuelle offre de l’Australie. Cette décision, bien que peu surprenante compte tenu du poids géopolitique et des ressources financières de Riyad, soulève de graves questions sur les valeurs de la FIFA et la crédibilité de son engagement en matière de droits humains.
Une réponse divisée
Les partisans de cette décision estiment qu’organiser un événement sportif majeur en Arabie saoudite pourrait ouvrir une voie vers des réformes. La journaliste sportive renommée Tracey Holmes l’a qualifié d’« opportunité unique pour un changement social positif ». Des messages de félicitations ont afflué du monde entier, adressés à l’Association saoudienne de football et au prince héritier Mohammed ben Salmane, reflétant une acceptation croissante parmi les élites.
Mais cette vision optimiste est loin d’être unanime. Les organisations de défense des droits humains ont vivement critiqué la décision. Human Rights Watch a prédit sans détour : « Il est presque certain que la Coupe du monde 2034 sera entachée de violations massives des droits humains. » Amnesty International et d’autres groupes ont exprimé des préoccupations similaires, pointant les atteintes saoudiennes à la liberté d’expression, aux droits des femmes et aux droits des personnes LGBTQIA+.
Les engagements de la FIFA en matière de droits humains
Depuis 2017, la FIFA affirme suivre une politique fondée sur les « Principes de Ruggie » des Nations Unies, reposant sur trois obligations fondamentales :
-
Les gouvernements doivent protéger les droits humains ;
-
Les entreprises doivent respecter les droits humains et remédier aux abus ;
-
Les victimes doivent avoir accès à des recours efficaces.
La FIFA promet d’« exercer son influence » pour prévenir et traiter les atteintes aux droits humains dans ses opérations. Elle s’engage aussi à « promouvoir » leur protection. Pourtant, en attribuant la Coupe du monde à un pays au lourd passif en matière de droits humains, elle met sérieusement en péril la crédibilité de cette politique.
Les précédentes Coupes du monde : histoire et occasions manquées
L’histoire montre que les grands événements sportifs n’ont guère favorisé d’améliorations majeures en matière de droits humains.
-
Russie 2018 : Malgré des accusations de corruption et des tensions géopolitiques, la Russie a accueilli la Coupe du monde, marquée par la répression des journalistes, des militants et des personnes LGBTQIA+.
-
Qatar 2022 : Le Qatar avait promis des réformes du travail, mais des milliers de travailleurs migrants sont morts, et les restrictions sur les femmes, les LGBTQIA+ et la presse sont restées fortes.
Le passif préoccupant de l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite criminalise l’homosexualité, restreint les droits des femmes, limite la liberté d’expression et a été impliquée dans des assassinats extrajudiciaires, notamment celui du journaliste Jamal Khashoggi.
En juillet 2024, la FIFA a publié un résumé exécutif évaluant les risques liés aux droits humains pour 2034. Elle a classé les risques comme « moyens », tout en affirmant qu’il existait un « bon potentiel » d’amélioration. Pourtant, le document de candidature saoudien, un rapport de 28 pages, reste silencieux sur les droits LGBTQIA+, la liberté de la presse et les droits des minorités.
Droits des travailleurs : un signal d’alarme majeur
La question la plus préoccupante concerne les droits des travailleurs. L’Arabie saoudite reconnaît de sérieuses lacunes et promet des réformes, notamment contre le travail forcé. Mais la méfiance persiste. Le pays dépend de 13 millions de travailleurs migrants, souvent exposés à des conditions de travail dangereuses.
Une enquête du Guardian a révélé qu’en 2022, 1 500 travailleurs bangladais sont morts en Arabie saoudite, souvent d’épuisement ou d’accidents évitables. Sans protections solides et surveillance indépendante, le risque de tragédies similaires reste élevé.
Pourquoi continuer à attribuer la Coupe du monde à des régimes autoritaires ?
La FIFA prétend que la Coupe du monde peut stimuler les progrès dans des pays aux bilans douteux, mais cette conviction semble plus rhétorique que réelle. En pratique, l’événement est attribué à ceux qui peuvent se le permettre financièrement.
Organiser une Coupe du monde coûte des milliards, et beaucoup de démocraties hésitent de plus en plus à assumer un tel fardeau. L’Australie avait montré un intérêt pour 2034, mais son projet s’est effondré après le soutien de l’AFC à l’Arabie saoudite.
Portée par ses pétrodollars et une vision nationale ambitieuse, Riyad a mené une campagne agressive. Cela s’inscrit dans une stratégie de « sportwashing », comprenant l’achat de clubs sportifs, le LIV Golf, et l’organisation de compétitions de boxe et de Formule 1.
Le football est-il utilisé pour masquer des réalités peu reluisantes ?
En confiant l’édition 2034 à l’Arabie saoudite, la FIFA compromet gravement sa crédibilité comme défenseur des droits humains. Malgré ses grands discours, l’organisation semble avant tout motivée par l’argent et l’influence.
Bien que certains espèrent que la pression médiatique incitera à des réformes, l’histoire offre peu d’exemples encourageants. À moins que la FIFA n’impose des critères de droits humains stricts et contraignants, la Coupe du monde risque davantage de devenir une vitrine de répression que de progrès.