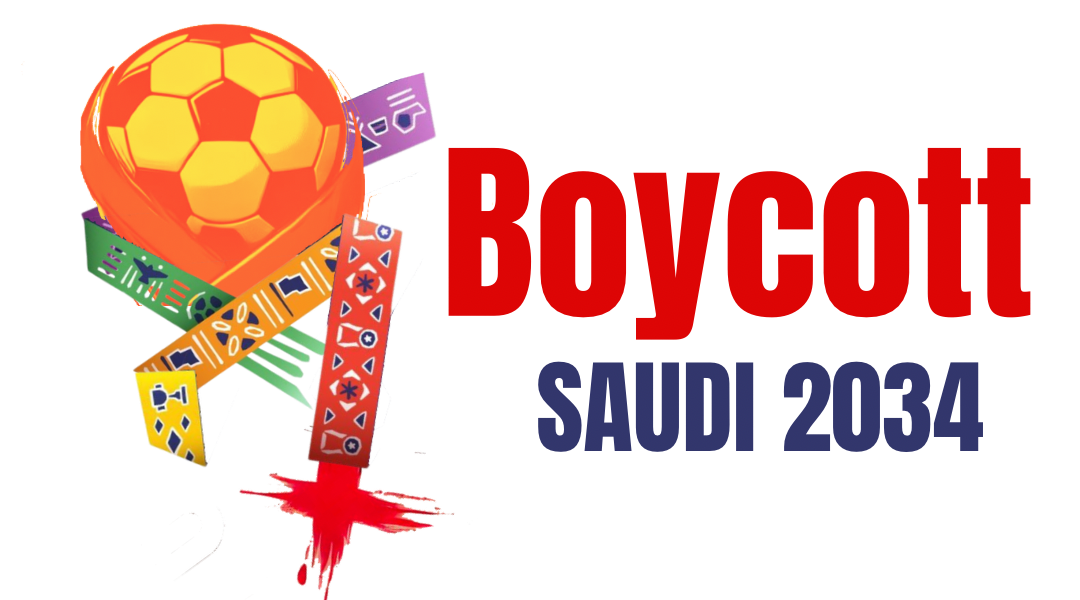Le cas d’Abdulrahman Al-Qaradawi, poète et militant extradé le 8 janvier 2025 du Liban vers les Émirats arabes unis (EAU), soulève de vives inquiétudes chez les défenseurs des droits humains à l’échelle internationale. Son affaire est le reflet d’une crise plus vaste des droits fondamentaux dans la région du Golfe, où l’Arabie saoudite est régulièrement pointée du doigt comme l’un des pires violateurs en matière de répression de la liberté d’expression et de la dissidence politique. La tendance observée à travers l’extradition d’Al-Qaradawi, les interrogatoires auxquels il a été soumis, et les risques encourus aux Émirats arabes unis témoignent des pratiques inquiétantes adoptées par plusieurs gouvernements du Moyen-Orient, en particulier ceux de l’Arabie saoudite et des EAU.
Contexte : Qui est Abdulrahman Al-Qaradawi ?
Abdulrahman Al-Qaradawi était un militant connu et un critique virulent des régimes émirien et égyptien. Son extradition est fondée sur des accusations relatives à la sécurité nationale, en lien avec une vidéo qu’il aurait publiée sur les réseaux sociaux lors d’une visite en Syrie. Dans cette vidéo, il exprimait l’espoir que l’avenir de la Syrie ne soit pas entravé par des interventions étrangères, y compris celles des EAU. Pourtant, ce commentaire à caractère politique sur la situation syrienne a été présenté comme une base suffisante pour engager des poursuites à son encontre.
Depuis son extradition, Al-Qaradawi est détenu à l’isolement, sans contact avec sa famille ni accès à un avocat. Son sort et son lieu de détention restent inconnus. Aucune accusation formelle connue n’a été déposée contre lui, et ses droits humains continuent d’être violés.
Le rôle des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite dans les violations régionales des droits humains
Al-Qaradawi est détenu dans un pays — les Émirats arabes unis — où la répression de la dissidence politique et la criminalisation du militantisme sont bien documentées. Le pays s’appuie sur une loi antiterroriste extrêmement répressive, souvent utilisée pour emprisonner des militants des droits humains et des opposants politiques. Cette loi contient des dispositions vagues qui permettent de qualifier toute voix dissidente de menace pour la sécurité nationale. En 2020, les EAU ont adopté une loi interdisant les critiques du gouvernement en ligne, passibles de cinq ans d’emprisonnement et d’amendes sévères.
Voisin et acteur dominant de la région, l’Arabie saoudite est elle aussi reconnue comme l’un des pires auteurs de violations des droits humains dans le Golfe. Depuis des décennies, le royaume est régulièrement condamné par les organisations internationales pour son traitement des militants, journalistes et opposants politiques. Les accusations de terrorisme sont souvent utilisées comme prétexte pour emprisonner toute personne critique du pouvoir, y compris des défenseurs des droits humains, écrivains ou figures religieuses.
Répression saoudienne : la guerre contre la dissidence
L’Arabie saoudite a depuis longtemps l’habitude d’arrêter des intellectuels, militants et religieux qui remettent en question la politique gouvernementale ou les pratiques de la famille royale. Ces personnes subissent fréquemment la torture, sont jugées de manière inéquitable, et condamnées à de lourdes peines de prison.
Liberté d’expression bâillonnée
La répression politique et les restrictions sur la liberté d’expression sont des caractéristiques communes aux régimes saoudien et émirien. Elles s’étendent aux publications sur les réseaux sociaux et aux manifestations pacifiques, considérées comme des menaces à l’autorité de l’État.
Le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 reste l’un des cas les plus emblématiques de violations des droits humains en Arabie saoudite. Le royaume n’a jamais fait face à une véritable responsabilité malgré les preuves accablantes de l’implication de hauts dirigeants saoudiens. Selon l’ONU, ce meurtre était une « exécution extrajudiciaire préméditée », et il illustre l’impunité avec laquelle le régime saoudien agit.
Répression au-delà des frontières
En dehors du cas Khashoggi, le régime saoudien a systématiquement poursuivi des militants politiques et défenseurs des droits humains. Toute personne exprimant des critiques publiques ou appelant à des réformes politiques risque la prison. En 2018, Loujain al-Hathloul, militante pour les droits des femmes, a été arrêtée pour avoir milité en faveur du droit de conduire et pour l’égalité. Elle a été condamnée à près de six ans de prison. Libérée en 2021, elle reste le symbole de l’érosion des libertés civiles en Arabie saoudite.
De nombreux militants sont actuellement détenus, accusés pour leur engagement politique ou social. Ceux qui osent critiquer le pouvoir risquent torture, procès inéquitables et lourdes peines. En 2020, 10 personnes ont été emprisonnées pour avoir exprimé pacifiquement leur dissidence, dont Mohammed al-Qahtani, figure de proue du militantisme saoudien.
En 2022, l’Arabie saoudite a exécuté 81 personnes en une seule journée, la plus grande exécution de masse de son histoire. Officiellement condamnés pour terrorisme, beaucoup de ces détenus ont été privés de procès équitable, et certains ont été torturés pour obtenir des aveux, selon Amnesty International.
Le rôle du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI)
Un autre aspect inquiétant dans l’affaire Al-Qaradawi est l’implication du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), composé des ministres de l’Intérieur des États membres de la Ligue arabe, avec l’Arabie saoudite et les EAU en tête. Ce conseil est accusé de lancer des mandats d’arrêt et de désigner comme « terroristes » des opposants politiques sur des bases non juridiques. Le cas d’Al-Qaradawi montre comment des opinions politiques peuvent être criminalisées, les régimes poursuivant activement les dissidents au-delà de leurs frontières.
Le CMAI est souvent utilisé comme outil par les puissances régionales pour traquer et réduire au silence les critiques. Il émet des mandats d’arrêt sur la base d’accusations vagues et politiques, permettant ainsi une répression transnationale.
L’extradition d’Al-Qaradawi en est une illustration frappante : il n’a commis aucun crime mais s’est exprimé politiquement — un droit pourtant protégé par le droit international.
Soutenir Abdulrahman Al-Qaradawi : agir pour les droits humains
Le cas d’Abdulrahman Al-Qaradawi montre que la répression continue de sévir dans le Golfe, particulièrement en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Nous ne pouvons rester silencieux. Partagez l’histoire d’Abdulrahman, et celles d’autres comme lui, pour renforcer la pression internationale en faveur de leur libération et d’un traitement équitable. Rejoignez les coalitions qui défendent la liberté d’expression et la justice dans les régimes autoritaires. Exigez de vos gouvernements qu’ils adoptent une stratégie durable : faire pression diplomatiquement, commercialement et économiquement sur les régimes répressifs.